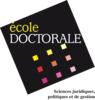13/06 - Soutenance de thèse de Mme Clara BERMANN
Mme Clara BERMANN soutient sa thèse de droit privé intitulée "Le produit sportif durable : d'un droit des déchets à un droit de l'économie circulaire" le 13 juin 2025 à 14h en salle des Actes de la FSJPS (1 place Déliot ,Lille). Elle a été préparée sous la direction du Pr. Denis Voinot, au CRDP, en CIFRE chez Décathlon.
Membres du jury
| M. Denis VOINOT | Université de Lille | Directeur de thèse |
| Mme Séverine NADAUD | Université de Limoges | Rapporteure |
| Mme Sophie MOREIL | Université du Littoral Côte d'Opale | Rapporteure |
| M. Patrick MEUNIER | Université de Lille | Président |
| Mme Noémie WALLAERT | Invitée |
| Résumé : |
La transition vers une économie circulaire impose de repenser en profondeur nos modes de production, de consommation et d’usage. À la croisée du droit de l’environnement, du droit économique et de la politique des déchets, le produit sportif constitue un terrain d’observation privilégié. Cette thèse propose une lecture juridique renouvelée du produit sportif durable, en partant du droit des déchets pour en dégager une trajectoire vers un véritable droit de l’économie circulaire. L’analyse s’articule autour du cycle de vie du produit, de sa conception à sa fin d’usage, en interrogeant les leviers juridiques de la circularité et de la performance. Elle examine notamment la requalification des déchets en ressources, la responsabilité élargie du producteur, l’écoconception, la réparation, le réemploi, la traçabilité, ainsi que la structuration de filières spécifiques telles que celles des articles de sport ou des textiles. En élargissant le champ à de nouveaux modes d’usage — location, mutualisation, économie de la seconde main —, la recherche met en lumière les tensions normatives à l’œuvre et questionne l’adaptation du droit face à l’évolution des pratiques. Elle plaide pour la reconnaissance du produit sportif non plus comme simple vecteur de performance, mais comme objet juridique durable, inscrit dans une économie soucieuse des limites planétaires. |