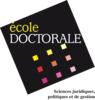04/07 - Soutenance de thèse de Mme Pauline CHEVALIER
Mme Pauline CHEVALIER soutient sa thèse intitulée "Le conseil départemental à l'épreuve du binôme d'élu·es. Contribution à une sociologie des rôles politiques en contexte paritaire" le 4 juillet à 9h00 en salle des Actes (FSJPS, 1 place Déliot à Lille). Elle a été préparée sous la codirection des Pr. Rémi Lefebvre et Nicolas Bué au sein du CERAPS.
Membres du jury
| M. Rémi LEFEBVRE | Université de Lille | Directeur de thèse |
| M. Christian LE BART | IEP Rennes | Rapporteur |
| M. Nicolas BUÉ | Université de Lille | Co-directeur de thèse |
| Mme Marion PAOLETTI | Université de Bordeaux | Rapporteure |
| M. Guillaume MARREL | Avignon Université | Examinateur |
| Mme Christine PINA | Université Côte d'Azur | Examinatrice |
| Mme Sandrine LÉVÊQUE | Sciences Po Lille | Examinatrice |
| Résumé : |
Cette thèse pose la question des effets de l’application de la parité sur l’institution ancienne et stabilisée qu’est l’ancien conseil général devenu départemental. La modification du mode de scrutin, en instaurant un binôme d’élu·es sur des cantons redécoupés, mode de scrutin totalement inédit, représente un bouleversement profond du mandat départemental, et renouvelle les questionnements sur le rôle de conseiller·e départemental·e. L’enquête ethnographique menée sur trois départements différents, combinée à une analyse statistique de données obtenues par questionnaire sur les conseillers et conseillères départementales élues au niveau national, permet de montrer que l’application de la parité et la mise en place des binômes a finalement des effets mineurs sur l’institution départementale, où les routines institutionnelles enracinées résistent au changement. La féminisation modifie à la marge le profil socio-professionnel des élu·es, et maintient les femmes dans une position dominée vis-à-vis des hommes, qui continuent de maîtriser les règles du jeu politique. Le binôme, qui oblige à penser le travail de représentation politique à deux alors qu’il a été toujours été pensé de manière individuelle, est finalement peu opérant dans l’organisation du travail politique. Sur le territoire cantonal en particulier, l’élargissement des cantons favorise la mise en place d’un travail autonome en procédant à une division du territoire. Le caractère individuel du travail politique, qui alimente les carrières, elles aussi pensées sur un mode individuel, entretient le statu quo et l’appui sur les pratiques antérieures, alors que les sortant·es sont encore très présent·es. L’étude du binôme et de la parité permet d’analyser le rôle de conseiller·e départemental·e. Celui-ci apparaît fragilisé par les réformes successives, au-delà de celle du mode de scrutin, et octroie moins de ressources à celles et ceux qui l’endossent. Il reste malgré tout un mandat convoité dans le marché des positions politiques, dans un contexte de limitation de cumul vertical des mandats. C’est là que réside toute l’ambivalence du mandat départemental. |